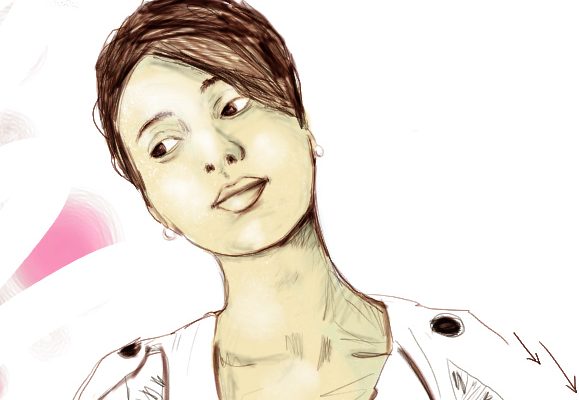J’ai 12-13 ans. Je sors de chez le coiffeur et, prenant le chemin de la maison, je marche à pas lents, fière de mes longs cheveux que j’ai impeccablement lissés à l’approche de la rentrée scolaire. Mes parents, de loin, m’aperçoivent, chevelure au vent. A peine ai-je franchi le seuil de la porte qu’ils me grondent. Et cela car depuis quelques semaines, des filles du voisinage se font régulièrement arrêter par des policiers les suspectant d’être ces voleuses de petite taille, à la peau mate et aux longs cheveux noirs dont les épiciers se plaignent. Tout le monde soupçonne les «mauvaises» filles roms d’être coupables. Alors, les parents apeurés demandent à leurs «bonnes» filles de se protéger, de protéger la famille, en veillant à garder leurs cheveux attachés. Pour faire la différence. Je me souviens encore qu’en cours de sport, nous étions trois ou quatre filles à refuser de nous mettre en maillot de bain par peur du regard moqueur des garçons. Par la suite, on proposa à mes amies de rencontrer une psychologue tandis que l’on m’envoya dans le bureau d’une assistante sociale qui me demanda si c’était mon père ou mes frères qui m’interdisaient de montrer mon corps. Par crainte que mon père soit convoqué, manque un jour de travail et doive s’en expliquer au patron de l’usine, j’ai accusé mes frères. Frères qui n’existaient pas puisque ma mère n’a eu que des filles. Je me souviens aussi des nombreuses fois où je dus, en urgence, accompagner des proches à l’hôpital et où je finis, à force, par ne plus traduire – du français vers l’arabe – les commentaires dénigrants, dégradants qui accompagnaient le processus d’accueil du patient et la compréhension de ce dont il souffrait.
Des expériences enfantines, adolescentes, ordinaires et longtemps indicibles qui, chacune à leur manière, m’ont marquée et ont fait naître en moi de nombreuses questions : celle de mon apparence, de ma respectabilité, de ma valeur de fille, de l’honneur de ma famille.
Puis, j’ai grandi. Je me suis formée.
Je suis devenue sociologue et écrivaine. Cet acte d’écrire romans et articles scientifiques m’a permis de dédoubler mes chances de ne plus seulement être une image pour les autres mais de me dire moi-même, de porter ma propre voix et d’être portée par elle, en retour. Au sein des mondes artistiques et savants, pourtant, j’ai continué à être confrontée à des sentiments qui me dépassaient et dont je ne savais que faire tant, eux, avaient déjà commencé à faire quelque chose de moi. Je veux parler de ce sentiment de honte, de culpabilité, d’infidélité. Je veux parler, aussi, de ce sentiment de devoir dire merci, de décevoir, et d’être, à tout moment, excluable. J’habitais alors un habitat inhabitable car n’y résonnaient que contradictions, injonctions, rappels à l’ordre, sommations, intimidations.
Mais écrire pousse à tout remettre continûment sur le métier. Ecrire m’a renforcée et j’ai commencé à vouloir, à partir de cet habitat, élucider la persistance en moi de ce profond sentiment d’inconfort.
Quittant provisoirement la France en raison d’un séjour doctoral à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) – Tunis, puis d’un séjour postdoctoral à UCLA, Los Angeles – j’ai éprouvé le trouble intérieur que provoquent les effets de lieu. D’échanges, en lectures, en séminaires, en conférences, j’ai commencé à entrevoir les potentiels processus croisés d’infériorisation, d’altérisation, d’exotisation, auxquels il m’était arrivé d’être sujette au sein de la société française. Je me souviens précisément de cet instant où je sus qualifier ma position. Une position à l’intersection et dont il me devenait possible de faire une critique émancipatrice, à travers ce qu’on nomme l’intersectionnalité : soit cette approche scientifique des travaux militants développés par les féministes africaines américaines et chicanas mettant en évidence la pluralité entrecroisée des rapports de domination – parmi lesquels les rapports de classe, de genre et de race. De là, mon regard sur moi-même, sur ma trajectoire familiale, scolaire, professionnelle, artistique, et sur ce qui, en général, m’entourait, a peu à peu changé. Je comparerais volontiers cela à une révolution tant intime que politique : j’ai cessé de croire en la complexité inadéquate de mes identités multiples – complexité à laquelle personne n’échappe – pour mieux réfléchir à l’exposition, de celles-ci aux forces indissociables des normes de classe, hétéro-masculines et de race.
De retour en France, l’inconfort n’avait pas disparu, certes, mais il m’était possible de le décrire. C’était, à mes yeux, une grande avancée que de pouvoir pointer du doigt l’adversité et l’injustice sociales que j’observais et éprouvais au quotidien. C’était comme, d’un coup, avoir prise sur ma propre existence.
A la lecture de l’entretien que Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, a accordé au Journal du dimanche et dans lequel il affirmait sans ambages vouloir combattre la «matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses intersectionnelles, qui veulent essentialiser les communautés et les identités, aux antipodes de notre modèle républicain», je ne peux, alors, que constater la tentative politique d’illégitimer et de criminaliser une démarche intellectuelle ; de rejeter une réalité impensable par le groupe majoritaire et devant donc demeurer impensée par les groupes subalternes ; de dénier à une partie de la population française le droit de faire valoir son vécu.
Or, depuis un certain temps maintenant, des modes vigoureux de dénonciation et d’énonciation des injustices systémiques ont été activés et ces derniers ne pourront plus être désactivés. Manifestement, je suis donc loin d’être la seule qui, à l’heure actuelle, mais cheminant de longue date dans la conscience de l’histoire des luttes collectives passées, travaille à (ré) envisager sa position minoritaire telle une puissante source d’expression artistique et culturelle de soi, ainsi qu’un véritable levier politique de subversion des représentations sociales. En témoignent les publications croissantes d’ouvrages écrits par des personnes racisées qui, ne craignant plus les récupérations ou les menaces de disqualification, posent frontalement la question du maintien d’une partie de la population française sous un régime politique d’infériorité et d’exceptionnalité. En témoigne aussi le déploiement, au sein d’espaces sociaux divers, de querelles relatives à la question subalterne ; ce qui signale sa constitution lente mais certaine comme enjeu démocratique légitime. En témoigne enfin la multiplication de dispositifs revendicatifs : véritables «arènes parallèles», selon l’expression de la philosophe Nancy Fraser, où s’élaborent, virtuellement et réellement, de puissantes tentatives d’interprétations de nos existences qui s’émancipent ainsi des regards surplombants, jugeants et avilissants.
Qu’est-ce qui s’empare de nous qui prenons alors la parole ? Une soif terrible de trouver, selon les mots de l’écrivaine Toni Morrison, la source de l’amour-propre. La volonté de mener une vie délivrée des assignations et des discriminations sociales. Le rêve que se réalise, enfin, pour tous ceux et toutes celles à qui il a été promis, un jour, l’idéal universel. Et, à cela, nous veillerons farouchement.